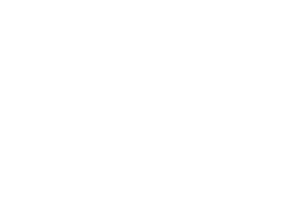Une complication fréquente
L’hypertension touche entre 5 et 10 % des femmes enceintes, principalement lors d’une première grossesse dans un cas sur quatre. Il s’agit de la complication obstétricale la plus courante, bien connue de la communauté scientifique.
Même avec de saines habitudes de vie et une grossesse bien préparée, certains imprévus peuvent survenir. L’hypertension artérielle en est un exemple typique : elle peut apparaître sans prévenir et bouleverser les plans initiaux. Aussi appelée hypertension gravidique, hypertension gestationnelle ou encore haute pression pendant la grossesse, cette condition mérite d’être bien comprise.
Qu’est-ce que la tension artérielle?
Hypertension gravidique : définition et enjeux
L’hypertension gravidique est l’une des complications les plus fréquentes de la grossesse. On la diagnostique lorsqu’une femme enceinte présente une tension artérielle égale ou supérieure à 140/90 mm Hg, même au repos.
Lorsque les valeurs atteignent 160/110 mm Hg ou plus, on parle alors d’hypertension sévère. Cette élévation de la pression artérielle signifie que le cœur doit travailler davantage, ce qui peut entraîner des symptômes variés, des effets secondaires et affecter d’autres organes comme les reins ou le foie. La santé de la mère et du bébé peut alors être compromise.
Le traitement est établi par un professionnel de la santé, en tenant compte de la situation clinique globale et de la présence de facteurs de risque ou de protection. Des interventions seront proposées si la tension devient préoccupante, toujours dans le but d’assurer la sécurité de la mère et de l’enfant.
Classification de l’hypertension durant la grossesse
Lorsqu’on détermine la classification des différentes hypertensions durant la grossesse, on peut regarder différents marqueurs dans le sang, faire des échographies et voir des symptômes rénaux possibles comme des protéines dans les urines.
Différentes classifications possibles
Hypertension artérielle préexistante (1 à 2 % des femmes enceintes) :
L’hypertension artérielle préexistante ou chronique fait référence à la femme qui avait déjà de l’hypertension avant de devenir enceinte ou qu’elle l’a développée avant sa 20e semaine de grossesse.
Hypertension gestationnelle ou gravidique (5 à 7 % des cas) :
L’hypertension gravidique apparaît plutôt après 20 semaines de grossesse et encore plus dans le dernier trimestre de la gestation. Les femmes enceintes dépistées avant la 34e semaine de grossesse ont plus de risques de cheminer vers la pré‑éclampsie.
La prééclampsie : un diagnostic plus complexe
La prééclampsie est une forme plus précise et préoccupante d’hypertension pendant la grossesse. Elle se caractérise par une tension artérielle élevée — chronique ou gravidique — accompagnée d’autres signes cliniques qui indiquent un risque accru pour la santé de la mère et du fœtus.
Parmi ces signes, on retrouve des anomalies dans les analyses sanguines, notamment des marqueurs placentaires et hormonaux altérés, ainsi que la présence possible de protéines dans les urines. Ce dernier indicateur témoigne d’une surcharge des reins, qui ne parviennent plus à filtrer efficacement le sang, laissant passer des substances normalement réabsorbées, comme l’albumine.
D’autres manifestations peuvent s’ajouter, comme une atteinte hépatique ou rénale chez la mère, ou encore un retard de croissance chez le fœtus. Une enflure marquée (œdème) du visage et des extrémités est aussi fréquemment observée, bien qu’elle ne soit pas systématique. À noter que la prééclampsie peut parfoi s survenir sans protéinurie, ce qui souligne la complexité du diagnostic.
s survenir sans protéinurie, ce qui souligne la complexité du diagnostic.
La détection des protéines ou du sucre dans l’urine se fait à l’aide d’une bandelette réactive (Labstix) plongée dans un échantillon. Le résultat peut indiquer « trace » (généralement sans conséquence), ou des valeurs comme +1 ou +2, qui nécessitent une évaluation plus poussée et une surveillance rapprochée.
Symptômes et suivi
Autres formes d’hypertension pendant la grossesse
Il arrive qu’une tension artérielle élevée soit observée lors d’un rendez-vous, mais qu’elle revienne à la normale par la suite. On parle alors d’hypertension situationnelle, souvent liée à un facteur ponctuel comme un stress passager, un retard, une émotion vive ou même le simple fait de voir un professionnel en sarrau blanc. Dans ces cas, il s’agit généralement d’une hypertension transitoire, sans retentissement clinique.
Si une surveillance à domicile est recommandée, il est important de s’assurer que la femme enceinte utilise un brassard adapté à la taille de son bras et qu’elle applique une technique de mesure adéquate pour obtenir des résultats fiables.
Cause de l’hypertension gravidique
La cause exacte de l’hypertension gravidique et de la prééclampsie demeure inconnue, bien que certains facteurs puissent en augmenter le risque. Sur le plan physiologique, on observe souvent une perturbation de la circulation sanguine au niveau du placenta, ce qui entraîne un dysfonctionnement plus global et l’apparition des symptômes caractéristiques de la prééclampsie.
La présence de conditions préexistantes, comme le diabète ou certains troubles rénaux, peut également aggraver la situation et compliquer l’évolution de la grossesse.
Signes et symptômes de l’hypertension gravidique
L’hypertension gravidique se manifeste généralement après 20 semaines de grossesse, par une tension artérielle égale ou supérieure à 140/90 mm Hg. D’autres signes peuvent s’ajouter, avec une intensité et une fréquence variables selon les femmes, et parfois évoluer vers une prééclampsie.
Il est important de noter que les symptômes ne sont pas toujours cumulatifs, et qu’un seul d’entre eux peut suffire à motiver un suivi médical.
La prééclampsie peut survenir :
- précocement, avant 34 semaines (0,4 % des cas)
- entre 34 et 37 semaines (0,8 %)
- après 37 semaines (1,6 % des grossesses)
 Symptômes possibles à surveiller :
Symptômes possibles à surveiller :
- maux de tête persistants (céphalées)
- nausées importantes, avec ou sans vomissements
- difficultés à respirer (dyspnée)
- bourdonnements d’oreilles (acouphènes)
- troubles de la vision (phosphènes, éclairs, taches lumineuses)
- rots fréquents (réflexes ostéo-tendineux)
- tremblements, irritabilité
- diminution du débit urinaire,
- enflure (œdème) et présence de protéines dans les urines
Plus tard et si cela évolue vers la pré‑éclampsie plus sévère :
- vertiges
- peut avoir saignement et/ou pétéchies (veines éclatées donnant des points rouges sur la peau)
- douleurs épigastriques (douleur à l’estomac, sous les seins, souvent décrite par les mamans sous forme de « barre ») ou douleur au quadran supérieur droit de l’abdomen (sous la cage thoracique à droite) peut témoigner de l’atteinte du foie
- l’ajout de symptômes divers peut faire évoluer la pré‑éclampsie vers sa forme la plus grave appelée le « HELLP syndrome » avec atteinte de différentes fonctions et organes de la femme enceinte : rein, foie, sang, etc.
Quelles femmes sont plus à risque d’hypertension gravidique?
- celle qui a déjà fait de l’hypertension dans ses antécédents médicaux ou dans sa famille (histoire familiale)
- celle qui est enceinte pour la première fois (primipare)
- celle qui a déjà fait de l’hypertension ou pré‑éclampsie à une grossesse antérieure
- celle qui a des antécédents d’hypertension dans sa famille (mère, sœur)
- celle qui attend des jumeaux
- celle qui est âgée de 40 ans et plus (et/ou un écart de 10 ans entre 2 grossesses)
- celle qui ont un indice de masse corporelle à plus de 35, donc de l’obésité avant la grossesse
- celle qui souffre déjà d’un problème de santé chronique comme le diabète, un problème vasculaire ou rénal
Que faire pour prévenir l’hypertension gravidique?
- ne pas prendre d’alcool
- éviter de fumer (la nicotine peut accroître la haute tension)
- avoir une alimentation saine (pas d’évidence que la diminution du sel change quelque chose)
- faire de l’exercice
- prendre les multivitamines contenant de l’acide folique (idéalement en préconception)
- avoir un poids santé au début de la grossesse et prendre du poids normalement durant la grossesse
Les signes de l’hypertension gravidique sont nombreux et peuvent varier d’une femme à l’autre. Une vigilance adaptée permet d’en favoriser la détection précoce.
Traitements de l’hypertension gravidique
La prise en charge de l’hypertension gravidique varie selon la gravité de la situation et la présence ou non de signes de prééclampsie. Lorsque la pression est élevée mais sans complications associées, l’objectif est de stabiliser l’état de la femme enceinte et de prévenir une détérioration.
Les principales interventions peuvent inclure :
- une surveillance régulière du poids
- une réduction des activités quotidiennes ou du repos à domicile
- dans les cas plus sérieux, une hospitalisation avec alitement pour assurer un suivi étroit de la mère et du bébé
- une diminution des sources de stress
- au besoin, une médication adaptée, prescrite selon l’évaluation médicale individuelle (traitements par voie orale, comme l’aspirine, le calcium, le magnésium ou la bétaméthasone, selon les indications cliniques)
Chaque plan de traitement est personnalisé afin de protéger la santé de la mère tout en assurant le bon développement du bébé.
La prise de tension : une étape clé du suivi
Risques pour la mère et le bébé
Lorsque l’hypertension gravidique s’aggrave, elle peut évoluer vers une prééclampsie légère ou sévère, ou encore vers un syndrome HELLP. Ces complications exigent souvent une intervention urgente pour protéger la vie de la mère et de l’enfant, parfois au prix d’un accouchement prématuré.
Plus la prééclampsie est grave, plus les risques de complications sont élevés. Parmi les conséquences possibles pour la mère, on retrouve :
- le décollement placentaire
- des troubles vasculaires ou pulmonaires
- des troubles de la coagulation
Pour le bébé, l’hypertension maternelle peut entraîner un retard de croissance intra-utérin et augmenter le risque de naissance prématurée. Un suivi étroit est donc essentiel afin de limiter les impacts sur la santé de la mère et de son enfant.
Et après l’accouchement?
Après la naissance et l’expulsion du placenta, la tension artérielle tend généralement à se stabiliser. Il faut toutefois compter jusqu’à huit semaines pour qu’elle revienne à des valeurs considérées normales. C’est pourquoi un suivi postnatal est recommandé afin de surveiller l’évolution de la pression artérielle et le rétablissement global de la mère.
Dans le cas d’une prééclampsie précoce ou chez une femme présentant des facteurs de risque supplémentaires (hypertension chronique, diabète, troubles rénaux, grossesse multiple, obésité, âge maternel de 40 ans ou plus), un traitement préventif peut être envisagé lors d’une grossesse ultérieure. Il est alors fréquent que le médecin propose une prise d’aspirine à faible dose, débutée avant 16 semaines, afin de réduire le risque de complications. Ce traitement est sécuritaire, bien toléré et n’entraîne pas de saignements ou d’effets indésirables significatifs lorsqu’il est prescrit dans un contexte de grossesse à risque.
Il est également important de noter que l’allaitement est tout à fait possible après une grossesse compliquée par l’hypertension gravidique ou la prééclampsie.
En conclusion, bien que personne ne souhaite vivre ce type de complication, une meilleure compréhension des signes à surveiller permet une intervention plus rapide et efficace. L’objectif est d’offrir une information claire et rassurante, afin de soutenir les femmes dans la prévention et la gestion de l’hypertension durant la grossesse.
Marie Fortier
La spécialiste des bébés
Mise à jour : Mars 2025.
Références :
-
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. (2022). Hypertension gestationnelle et prééclampsie. Repéré le 24 mars 2025 à https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
-
JOGC. (2022). Directive clinique n° 426 : Troubles hypertensifs de la grossesse – Diagnostic, prédiction, prévention et prise en charge. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 44(5), 572‑597.e1. Repéré le 24 mars 2025 à https://www.jogc.com/article/S1701-2163(22)00235-3/abstract
-
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. (2019). GESTA : Troubles hypertensifs de la grossesse. Repéré le 24 mars 2025 à https://media.sogc.org/COVID19/preGESTA_Hypertension_Guide.pdf